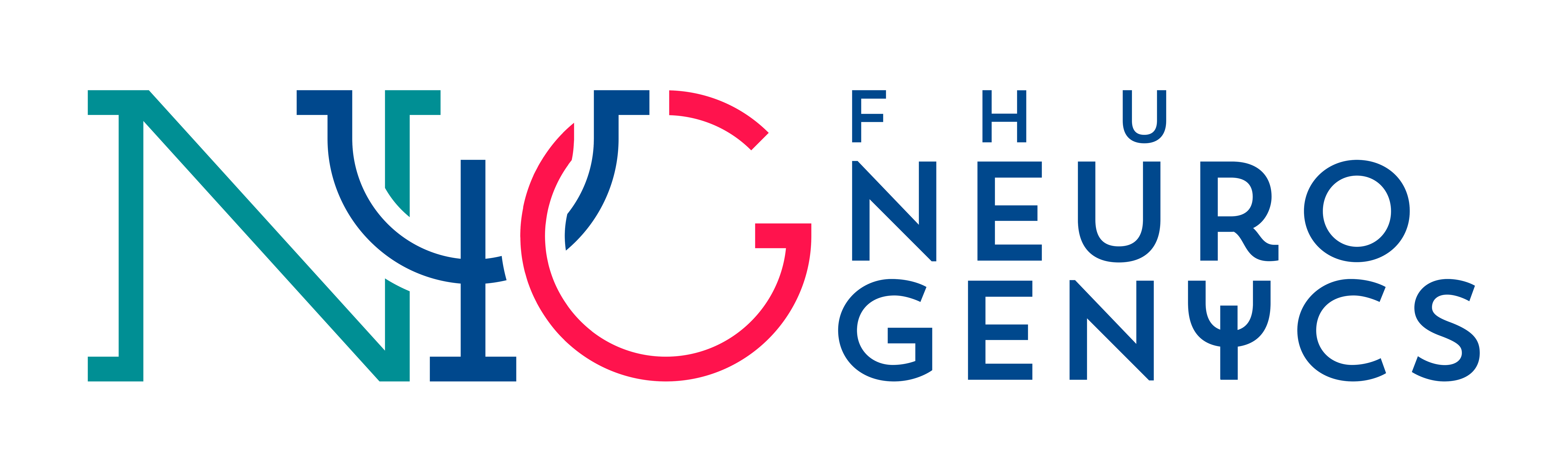Chaque année la FHU NEUROGENYCS soutien ses équipes en attribuant des financements spécifiques afin de soutenir la recherche clinique. Ces financements permettent par exemple aux investigateurs de prolonger leur projet ou de développer des études ancillaires…
Retrouvez en vidéo les projets lauréats de nos AAP NEUROGENYCS!
Les vidéos sont toutes disponibles sur notre chaine YouTube
Etude NEURO-PRF: Plasma enrichi en plaquettes en prévention de douleur neuropathique post-chirurgie d’hernie discale et dosage de l’expression de cytokines proinflammatoires. Dr Eric SALVAT (AAP EXTEND 2022)
Résumé du projet NEURO-PRF
La lombalgie aiguë est une des douleurs aiguës les plus fréquentes en pratique clinique. Son histoire naturelle est le plus souvent favorable puisque la guérison est habituellement obtenue en quelques semaines. Le problème apparait lorsque la lombalgie associée à une souffrance radiculaire persiste. Du point de vue clinique, il existe des facteurs de risque de développement d’une douleur radiculaire par conflit disco-radiculaire. Parmi ces patients, certains vont bénéficier d’une chirurgie rachidienne. Après chirurgie rachidienne, certains patients vont développer des douleurs chroniques résiduelles pour 10 à 50% d’entre eux selon les études.
Le développement de nombreux modèles expérimentaux de douleur neuropathique chez l’animal a permis de préciser une partie des mécanismes impliqués. La communication entre le système nerveux et le système immunitaire notamment via les cytokines au niveau périphérique ou central contribue au développement et au maintien des douleurs neuropathiques. L’étude des mécanismes d’installation et de maintien de la douleur neuropathique met l’accent depuis ces dernières années sur altération d’une balance neuro-immunitaire. En effet, suite à une lésion neurologique, l’activation des cellules immunitaires et gliales au sein du tissu nerveux que ce soit au niveau du nerf lésé, du ganglion spinal puis du névraxe conduit par un relargage de cytokines à l’installation puis au maintien de la douleur neuropathique. Ainsi, la modulation cytokinergique directe ou indirecte pourrait donc s’avérer une option thérapeutique efficace contre les douleurs neuropathiques. Il est montré que les facteurs de croissance comme le PDGF (Platelet Derived Growth Factor) diminuent la synthèse de cytokine pro-inflammatoire. Les plaquettes en plus de leur rôle bien connu lors de l’hémostase contiennent un nombre important de facteur de croissance (PDGF, Transforming Growth Factor…) qui pourrait jouer un rôle dans cette balance pro/anti-inflammatoire. Une technique de concentration des facteurs de croissance contenus dans les plaquettes permet d’obtenir du plasma enrichi en plaquettes (PRP) par centrifugation du sang total, puis prélèvement de la partie où se situent les plaquettes sanguines en grande quantité.
L’injection de PRP est un nouvel outil thérapeutique autologue qui a récemment émergé. Le PRP serait intéressant à utiliser aussi bien sur des douleurs neuropathique constituées qu’en prévention. En particulier dans la chirurgie rachidienne il permettrait la régénération nerveuse, aurait une action anti-inflammatoire et ainsi préviendrait l’apparition de douleurs neuropathique résiduelles postopératoires.
Notre essai est une étude clinique prospective, interventionnelle, contrôlée, en simple aveugle avec évaluation par un tiers aveugle, et de non infériorité. En collaboration avec l’équipe de neurochirurgie de Strasbourg, nous comparons un groupe contrôle chirurgie seule à un groupe chirurgie et PRP (30 patients hommes ou femmes dans chaque bras). Le critère de jugement principal est la survenue d’une douleur neuropathique postopératoire définit par une douleur radiculaire évoluant depuis plus de 3 mois avec un DN4 positif. Cette étude a démarré début 2022.
Parallèlement, nous doserons le profil d’expression d’ARN d’un panel de cytokines pro et antiinflammatoires dans le sang avant la chirurgie, 15 jours puis 6 mois après. Cette partie d’analyse de biologie moléculaire de notre étude se fait dans le cadre d’une collaboration académique avec l’équipe du Dr Laurent VALLAT et le plateau technique du laboratoire du département de génétique moléculaire des HUS. Cet axe d’analyse de notre étude permettra de mieux connaitre l’implication des cytokines dans la chronicisation des douleurs neuropathiques.
Le développement de nombreux modèles expérimentaux de douleur neuropathique chez l’animal a permis de préciser une partie des mécanismes impliqués. La communication entre le système nerveux et le système immunitaire notamment via les cytokines au niveau périphérique ou central contribue au développement et au maintien des douleurs neuropathiques. L’étude des mécanismes d’installation et de maintien de la douleur neuropathique met l’accent depuis ces dernières années sur altération d’une balance neuro-immunitaire. En effet, suite à une lésion neurologique, l’activation des cellules immunitaires et gliales au sein du tissu nerveux que ce soit au niveau du nerf lésé, du ganglion spinal puis du névraxe conduit par un relargage de cytokines à l’installation puis au maintien de la douleur neuropathique. Ainsi, la modulation cytokinergique directe ou indirecte pourrait donc s’avérer une option thérapeutique efficace contre les douleurs neuropathiques. Il est montré que les facteurs de croissance comme le PDGF (Platelet Derived Growth Factor) diminuent la synthèse de cytokine pro-inflammatoire. Les plaquettes en plus de leur rôle bien connu lors de l’hémostase contiennent un nombre important de facteur de croissance (PDGF, Transforming Growth Factor…) qui pourrait jouer un rôle dans cette balance pro/anti-inflammatoire. Une technique de concentration des facteurs de croissance contenus dans les plaquettes permet d’obtenir du plasma enrichi en plaquettes (PRP) par centrifugation du sang total, puis prélèvement de la partie où se situent les plaquettes sanguines en grande quantité.
L’injection de PRP est un nouvel outil thérapeutique autologue qui a récemment émergé. Le PRP serait intéressant à utiliser aussi bien sur des douleurs neuropathique constituées qu’en prévention. En particulier dans la chirurgie rachidienne il permettrait la régénération nerveuse, aurait une action anti-inflammatoire et ainsi préviendrait l’apparition de douleurs neuropathique résiduelles postopératoires.
Notre essai est une étude clinique prospective, interventionnelle, contrôlée, en simple aveugle avec évaluation par un tiers aveugle, et de non infériorité. En collaboration avec l’équipe de neurochirurgie de Strasbourg, nous comparons un groupe contrôle chirurgie seule à un groupe chirurgie et PRP (30 patients hommes ou femmes dans chaque bras). Le critère de jugement principal est la survenue d’une douleur neuropathique postopératoire définit par une douleur radiculaire évoluant depuis plus de 3 mois avec un DN4 positif. Cette étude a démarré début 2022.
Parallèlement, nous doserons le profil d’expression d’ARN d’un panel de cytokines pro et antiinflammatoires dans le sang avant la chirurgie, 15 jours puis 6 mois après. Cette partie d’analyse de biologie moléculaire de notre étude se fait dans le cadre d’une collaboration académique avec l’équipe du Dr Laurent VALLAT et le plateau technique du laboratoire du département de génétique moléculaire des HUS. Cet axe d’analyse de notre étude permettra de mieux connaitre l’implication des cytokines dans la chronicisation des douleurs neuropathiques.
Etude NEUROPLITZ: Recherche des facteur cliniques et neuropsychologiques permettant de discriminer deux sous-formes de schizophrénie. Pr Fabrice BERNA (AAP BOOST 2020)
Résumé du projet NEUROSPLITZ
Au cours des dernières décennies, les recherches étiopathogéniques sur la schizophrénie ont échoué dans leur tentative d’identifier des biomarqueurs spécifiques de ce trouble, qu’il s’agisse de biomarqueurs génétiques, inflammatoires, cérébraux ou cognitifs.
Un des facteurs majeurs responsable de cet échec est le constat largement partagé de l’inadaptation des classifications internationales (la CIM et le DSM) qui servent de base à la définition de la schizophrénie.
Pourtant, l’échec du paradigme catégoriel pourrait tout simplement s’expliquer par l’utilisation de phénotypes inadaptés à la réalité, ce qui ferait de son abandon une réaction inappropriée. De fait, les entités comme la schizophrénie ou le trouble schizo-affectif ont été définies par consensus et non pas à partir d’une base empirique, seule la reproductibilité inter-évaluateurs ayant fait l’objet d’études. À l’inverse, l’école de Wernicke-Kleist-Leonhard (WKL) a optimisé la description de phénotypes de psychoses endogènes en prenant pour base des observations diachroniques, en utilisant trois principes:
1) un principe neurophysiologique de hiérarchisation des symptômes en fonction du processus atteint,
2) un principe longitudinal qui suppose qu’un patient ne souffre que d’un seul phénotype au cours de sa vie quelle que soit la polymorphie de son expression clinique et,
3) un principe d’agrégation familiale posant l’hypothèse que les apparentés atteints d’une même famille souffrent du même phénotype.
Les cliniciens de cette école sont parvenus à identifier trente-cinq phénotypes majeurs qui se sont révélés reproductibles, prédictifs, et révèlent une bonne validité différentielle sur l’âge de début, la réponse au traitement, la charge héréditaire et ontogénique.
Récemment, nous avons confronté́ le modèle de la schizophrénie du DSM-5 à deux phénotypes WKL : la cataphasie et la catatonie périodique (Foucher et al. 2018). Si tous deux remplissent les critères de schizophrénie ou de trouble schizo-affectif dans plus de deux tiers des cas, ils se distinguent, au cours de leur phase aiguë et de leur phase résiduelle, par des symptômes spécifiques (i.e. présents uniquement dans un trouble et absents dans l’autre) : des troubles du langage dans la cataphasie et une désorganisation de la psychomotricité dans la catatonie périodique. De plus, la charge héréditaire est forte pour les deux phénotypes, mais spécifique, puisque les apparentés ne souffrent que de la même forme sans hérédité croisée.
Ces résultats sont les premiers à notre connaissance à avoir porté sur deux sous-groupes de schizophrénie définis par la classification de WKL. Ils nous incitent à poursuivre la recherche de marqueurs cliniques et cognitifs spécifiques de sous-formes de schizophrénie pour tester la validité de ce modèle et contribuer à réduire l’hétérogénéité qui caractérise le groupe des schizophrénies tel qu’il est défini par le DSM-5. Cette démarche guidée par la clinique et les hypothèses physiopathologiques qui le sous-tendent, nous apparaît essentielle pour pouvoir identifier des marqueurs étiopathologiques spécifiques de ces phénotypes.
Dans la présente étude, nous souhaitons comparer à présent deux autres phénotypes de trouble schizophrénique définis par WKL : la catatonie périodique et l’hébéphrénie. Toutes deux représentent des formes fréquentes de schizophrénie dont le pronostic à long terme est généralement sombre. Elles sont caractérisées par un syndrome négatif prononcé (associant apathie, apragmatisme, retrait social, réduction de l’expression des émotions), mais dont la physiopathologie serait distincte : atteinte de la psychomotricité pour la catatonie périodique et atteinte des affects de haut niveau pour l’hébéphrénie (émotions secondaires).
Nous souhaitons donc par une série de mesures cliniques, neuropsychologiques et neurophysiologiques (IRM cérébrale) relatifs à la dimension affective et la psychomotricité évaluer l’existence possible de marqueurs spécifiques de la symptomatologie négative observée dans ces deux populations. Nous faisons l’hypothèse que la symptomatologie négative dans l’hébéphrénie sera expliquée par une altération des émotions secondaires en l’absence d’atteinte de la psychomotricité alors que dans la catatonie périodique, la symptomatologie négative sera expliquée par une altération de la psychomotricité tout en respectant les affects de haut niveau.
Un des facteurs majeurs responsable de cet échec est le constat largement partagé de l’inadaptation des classifications internationales (la CIM et le DSM) qui servent de base à la définition de la schizophrénie.
Pourtant, l’échec du paradigme catégoriel pourrait tout simplement s’expliquer par l’utilisation de phénotypes inadaptés à la réalité, ce qui ferait de son abandon une réaction inappropriée. De fait, les entités comme la schizophrénie ou le trouble schizo-affectif ont été définies par consensus et non pas à partir d’une base empirique, seule la reproductibilité inter-évaluateurs ayant fait l’objet d’études. À l’inverse, l’école de Wernicke-Kleist-Leonhard (WKL) a optimisé la description de phénotypes de psychoses endogènes en prenant pour base des observations diachroniques, en utilisant trois principes:
1) un principe neurophysiologique de hiérarchisation des symptômes en fonction du processus atteint,
2) un principe longitudinal qui suppose qu’un patient ne souffre que d’un seul phénotype au cours de sa vie quelle que soit la polymorphie de son expression clinique et,
3) un principe d’agrégation familiale posant l’hypothèse que les apparentés atteints d’une même famille souffrent du même phénotype.
Les cliniciens de cette école sont parvenus à identifier trente-cinq phénotypes majeurs qui se sont révélés reproductibles, prédictifs, et révèlent une bonne validité différentielle sur l’âge de début, la réponse au traitement, la charge héréditaire et ontogénique.
Récemment, nous avons confronté́ le modèle de la schizophrénie du DSM-5 à deux phénotypes WKL : la cataphasie et la catatonie périodique (Foucher et al. 2018). Si tous deux remplissent les critères de schizophrénie ou de trouble schizo-affectif dans plus de deux tiers des cas, ils se distinguent, au cours de leur phase aiguë et de leur phase résiduelle, par des symptômes spécifiques (i.e. présents uniquement dans un trouble et absents dans l’autre) : des troubles du langage dans la cataphasie et une désorganisation de la psychomotricité dans la catatonie périodique. De plus, la charge héréditaire est forte pour les deux phénotypes, mais spécifique, puisque les apparentés ne souffrent que de la même forme sans hérédité croisée.
Ces résultats sont les premiers à notre connaissance à avoir porté sur deux sous-groupes de schizophrénie définis par la classification de WKL. Ils nous incitent à poursuivre la recherche de marqueurs cliniques et cognitifs spécifiques de sous-formes de schizophrénie pour tester la validité de ce modèle et contribuer à réduire l’hétérogénéité qui caractérise le groupe des schizophrénies tel qu’il est défini par le DSM-5. Cette démarche guidée par la clinique et les hypothèses physiopathologiques qui le sous-tendent, nous apparaît essentielle pour pouvoir identifier des marqueurs étiopathologiques spécifiques de ces phénotypes.
Dans la présente étude, nous souhaitons comparer à présent deux autres phénotypes de trouble schizophrénique définis par WKL : la catatonie périodique et l’hébéphrénie. Toutes deux représentent des formes fréquentes de schizophrénie dont le pronostic à long terme est généralement sombre. Elles sont caractérisées par un syndrome négatif prononcé (associant apathie, apragmatisme, retrait social, réduction de l’expression des émotions), mais dont la physiopathologie serait distincte : atteinte de la psychomotricité pour la catatonie périodique et atteinte des affects de haut niveau pour l’hébéphrénie (émotions secondaires).
Nous souhaitons donc par une série de mesures cliniques, neuropsychologiques et neurophysiologiques (IRM cérébrale) relatifs à la dimension affective et la psychomotricité évaluer l’existence possible de marqueurs spécifiques de la symptomatologie négative observée dans ces deux populations. Nous faisons l’hypothèse que la symptomatologie négative dans l’hébéphrénie sera expliquée par une altération des émotions secondaires en l’absence d’atteinte de la psychomotricité alors que dans la catatonie périodique, la symptomatologie négative sera expliquée par une altération de la psychomotricité tout en respectant les affects de haut niveau.
Etude Temps, Self et activités mentales: TMS appliquée sur le cervelet, preuves de concept thérapeutique pour la schizophrénie. Dr Anne GIERSCH et Dr Ellen JOOS (AAP Emergence 2017)
Résumé du projet Temps, self et activités mentales
La schizophrénie est définie par ses symptômes cliniques mais comprend également des troubles neurobiologiques et cognitifs. Une fragmentation de la pensée a depuis longtemps été décrite, qui traduit la difficulté des patients à organiser leur pensée et leurs actes de façon fluide. Aucun traitement
n’existe à ce jour pour ces troubles. Cette difficulté se répercute sur nombre de capacités cognitives,
qui toutes impliquent de planifier des séquences d’information avec une grande résolution temporelle.
Ces troubles sont associés à des altérations du traitement automatique des informations dans le temps, qui pourrait liée plus spécifiquement à la capacité de planification sur des échelles courtes et plus longues. Tous se passe comme si les patients avaient des difficultés à suivre et anticiper automatiquement des séquences d’informations de façon continue. La seule structure capable de coordonner des séquences à cette échelle temporelle est le cervelet. Celui-ci est aussi impliqué dans des phénomènes d’anticipation temporelle sur des plus longues durées.
La stimulation magnétique transcrânienne (TMS) est une voie thérapeutique prometteuse, mais son efficacité n’est pas encore reconnue. Les freins à son utilisation sont (1) une méconnaissance des mécanismes qui sous-tendent les effets de la stimulation, et (2) le nombre limité de modèles physiopathologiques à même de guider les stimulations. Notre projet translationnel est construit de façon à surmonter ces obstacles. Les données de l’équipe clinique nous mènent vers des hypothèses fortes et un modèle physiopathologique qui implique un réseau neuronal qui comprend le cervelet. Les données obtenues jusqu’ici nous donnent des outils d’évaluation comportementale et électrophysiologique chez l’homme. Ces outils sont actuellement appliqués chez l’animal et les données obtenues nous permettent d’explorer le rôle des connexions cérébello-corticales dans les comportements d’intérêts, et de comprendre les effets d’une stimulation au niveau du cervelet. Ces données doivent nous permettre d’optimiser les paramètres de stimulation par TMS adaptés chez l’homme. Nous cherchons ici à faciliter le transfert de connaissances des données fondamentales chez l’animal à l’application chez l’homme, sain dans un premier temps.
Dans ce projet, nous souhaitons vérifier l’effet de la TMS appliquée en regard du cervelet chez un groupe de 24 volontaires sains. La TMS sur le cervelet a déjà fait preuve de son innocuité chez les patients souffrant de schizophrénie et est également utilisée dans d’autres pathologies, mais il s’agit ici de vérifier l’efficacité d’un protocole sur des fonctions cognitives précises et de l’adapter au mieux des besoins de la schizophrénie.
Le projet apportera les informations nécessaires pour adapter des protocoles de TMS chez les
patients qui pourront compenser efficacement leurs symptômes. En effet, nous pensons qu’il est
nécessaire de renforcer la plasticité ou d’inhiber une activité cérébrale en y associant la fonction
cognitive qu’il s’agit de remédier. Nous associons TMS et cognition en élaborant des protocoles de
TMS pendant la réalisation d’une tâche cognitive, et en ciblant les processus neuronaux de la façon la
plus sélective possible, en calant les stimulations sur les signaux électroencéphalographiques et/ou
comportementales. Nous espérons ainsi développer des preuves de concept thérapeutiques
innovantes, et pouvoir ensuite réaliser une étude de faisabilité chez un groupe de patients que nous
aurons au préalable identifiés comme étant particulièrement altérés dans nos tâches temporelles
n’existe à ce jour pour ces troubles. Cette difficulté se répercute sur nombre de capacités cognitives,
qui toutes impliquent de planifier des séquences d’information avec une grande résolution temporelle.
Ces troubles sont associés à des altérations du traitement automatique des informations dans le temps, qui pourrait liée plus spécifiquement à la capacité de planification sur des échelles courtes et plus longues. Tous se passe comme si les patients avaient des difficultés à suivre et anticiper automatiquement des séquences d’informations de façon continue. La seule structure capable de coordonner des séquences à cette échelle temporelle est le cervelet. Celui-ci est aussi impliqué dans des phénomènes d’anticipation temporelle sur des plus longues durées.
La stimulation magnétique transcrânienne (TMS) est une voie thérapeutique prometteuse, mais son efficacité n’est pas encore reconnue. Les freins à son utilisation sont (1) une méconnaissance des mécanismes qui sous-tendent les effets de la stimulation, et (2) le nombre limité de modèles physiopathologiques à même de guider les stimulations. Notre projet translationnel est construit de façon à surmonter ces obstacles. Les données de l’équipe clinique nous mènent vers des hypothèses fortes et un modèle physiopathologique qui implique un réseau neuronal qui comprend le cervelet. Les données obtenues jusqu’ici nous donnent des outils d’évaluation comportementale et électrophysiologique chez l’homme. Ces outils sont actuellement appliqués chez l’animal et les données obtenues nous permettent d’explorer le rôle des connexions cérébello-corticales dans les comportements d’intérêts, et de comprendre les effets d’une stimulation au niveau du cervelet. Ces données doivent nous permettre d’optimiser les paramètres de stimulation par TMS adaptés chez l’homme. Nous cherchons ici à faciliter le transfert de connaissances des données fondamentales chez l’animal à l’application chez l’homme, sain dans un premier temps.
Dans ce projet, nous souhaitons vérifier l’effet de la TMS appliquée en regard du cervelet chez un groupe de 24 volontaires sains. La TMS sur le cervelet a déjà fait preuve de son innocuité chez les patients souffrant de schizophrénie et est également utilisée dans d’autres pathologies, mais il s’agit ici de vérifier l’efficacité d’un protocole sur des fonctions cognitives précises et de l’adapter au mieux des besoins de la schizophrénie.
Le projet apportera les informations nécessaires pour adapter des protocoles de TMS chez les
patients qui pourront compenser efficacement leurs symptômes. En effet, nous pensons qu’il est
nécessaire de renforcer la plasticité ou d’inhiber une activité cérébrale en y associant la fonction
cognitive qu’il s’agit de remédier. Nous associons TMS et cognition en élaborant des protocoles de
TMS pendant la réalisation d’une tâche cognitive, et en ciblant les processus neuronaux de la façon la
plus sélective possible, en calant les stimulations sur les signaux électroencéphalographiques et/ou
comportementales. Nous espérons ainsi développer des preuves de concept thérapeutiques
innovantes, et pouvoir ensuite réaliser une étude de faisabilité chez un groupe de patients que nous
aurons au préalable identifiés comme étant particulièrement altérés dans nos tâches temporelles
Etude EBIOMOUD: Les biomarqueurs épigénétiques sont-ils un indicateur de la sévérité du trouble de l’usage d’opiaces ? Une étude pilote avec le Pr Laurence LALANNE (AAP Support 2021)
Résumé du projet EBIOMOUD/BEBOP
Le trouble de l’utilisation des opioïdes (TUO ou Opioid Use Disorder/OUD) est une affection psychiatrique chronique et sévère, définie par une utilisation problématique d’opioïdes, qui altère considérablement le fonctionnement interpersonnel et social. Au cours des 10 dernières années, une augmentation spectaculaire de la prévalence du TUO et des décès par overdose a été observée dans plusieurs pays développés, en particulier aux Etats-Unis. De même, en France, la situation s’aggrave et représente désormais une crise majeure de santé publique.
Au cours des dernières décennies, il a été démontré que le TUO résulte des effets combinés de nombreux facteurs, qui ont été identifiés dans divers domaines de recherche, notamment la psychiatrie, la sociologie et la neurobiologie. Cette pluralité s’incarne dans un cadre théorique complet, le modèle biopsychosocial de l’addiction, composé d’éléments dont les effets ont été bien définis individuellement, mais qui restent mal caractérisés et mal compris lorsqu’ils sont associés.
Plus récemment, l’épigénétique comportementale est apparue comme une discipline prometteuse pour identifier les mécanismes moléculaires qui peuvent aider à expliquer comment les expériences de vie, en particulier les troubles psychiatriques et les difficultés sociales, modulent la régulation des gènes, la fonction cérébrale et la régulation émotionnelle.
Dans ce contexte, nous proposons un projet multidisciplinaire qui s’appuie sur la collaboration de psychiatres, de sociologues et de neuro-épigénéticiens. Nous caractériserons simultanément les principaux facteurs psychiatriques et sociaux dans une vaste cohorte de personnes souffrant de troubles de l’usage d’opioïdes, dans le but de couvrir tout le spectre de la sévérité de la maladie. En combinant une évaluation psychosociale approfondie avec l’étude de biomarqueurs épigénétiques dans le sang, nous souhaitons améliorer notre compréhension des déterminants de la sévérité du TUO.
Au cours des dernières décennies, il a été démontré que le TUO résulte des effets combinés de nombreux facteurs, qui ont été identifiés dans divers domaines de recherche, notamment la psychiatrie, la sociologie et la neurobiologie. Cette pluralité s’incarne dans un cadre théorique complet, le modèle biopsychosocial de l’addiction, composé d’éléments dont les effets ont été bien définis individuellement, mais qui restent mal caractérisés et mal compris lorsqu’ils sont associés.
Plus récemment, l’épigénétique comportementale est apparue comme une discipline prometteuse pour identifier les mécanismes moléculaires qui peuvent aider à expliquer comment les expériences de vie, en particulier les troubles psychiatriques et les difficultés sociales, modulent la régulation des gènes, la fonction cérébrale et la régulation émotionnelle.
Dans ce contexte, nous proposons un projet multidisciplinaire qui s’appuie sur la collaboration de psychiatres, de sociologues et de neuro-épigénéticiens. Nous caractériserons simultanément les principaux facteurs psychiatriques et sociaux dans une vaste cohorte de personnes souffrant de troubles de l’usage d’opioïdes, dans le but de couvrir tout le spectre de la sévérité de la maladie. En combinant une évaluation psychosociale approfondie avec l’étude de biomarqueurs épigénétiques dans le sang, nous souhaitons améliorer notre compréhension des déterminants de la sévérité du TUO.
Etude TOTEM RRMS: Traitement des la SEP-RR par la testostérone: effets potentiels sur la neuroprotection et la remyélinisation avec le Pr Nicolas COLLONGUES (AAP Emergence 2017)
Résumé du projet TOTEM-RRMS
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique chronique auto-immune dont les manifestations cliniques principales sont associées à une inflammation et une démyélinisation du système nerveux central (SNC).
Les traitements actuels sont limités à des agents anti-inflammatoires, et il existe un besoin urgent de thérapies innovantes capables de promouvoir la neuroprotection et la réparation de la myéline.
De nombreuses études épidémiologiques et cliniques ont mis en évidence des différences entre la femme et l’homme :
– Environ 3/4 des patients atteints de SEP sont des femmes.
– Les hommes déclarent une SEP de façon plus tardive (au moment où les taux de testostérone baissent), mais souffrent généralement de symptômes plus sévères sur le plan clinique, et se dégradent plus vite que les femmes.
– Une activité bénéfique des hormones sexuelles sur l’évolution de la maladie a été constatée (activité des œstrogènes durant la grossesse chez les femmes et de la testostérone chez les hommes).
– Les hommes atteints de SEP peuvent avoir un taux de testostérone inférieur au taux moyen.
Ces écarts entre les sexes dans la SEP pourraient être liés entre autre à des facteurs génétiques liés au sexe, à des différences dans la réponse immune ou à des effets des hormones sexuelles.
Ces observations ont stimulé l’intérêt pour les effets protecteurs potentiels des hormones sexuelles, et en particulier de la testostérone chez les patients atteints de SEP.
Les données actuelles montrent que la testostérone agit selon trois effets distincts: 1) un effet anti-inflammatoire 2) un effet neuroprotecteur et 3) un effet remyélinisant.
Ainsi l’objectif principal de l’étude TOTEM sera de déterminer par IRM les bénéfices du traitement sur l’évolution des marqueurs de neuroprotection et de remyélinisation que sont respectivement l’atrophie du thalamus et l’analyse du tenseur de diffusion dans les lésions. La tolérance au traitement ainsi que son efficacité seront également évaluées en utilisant d’autres séquences IRM, diverses échelles cliniques, cognitives et de qualité de vie, de fatigue et d’anxiété/dépression.
Cette étude est justifiée par le mécanisme d’action original de la testostérone agissant sur la neuroprotection et la remyélinisation dans la SEP, ainsi que son excellente tolérance. Ces modalités d’action représentent une nouvelle voie thérapeutique qui n’a pas d’équivalent dans l’arsenal thérapeutique actuel utilisé dans la SEP. Il n’existe notamment aucune molécule ayant une efficacité neuroprotectrice ou remyélnisante propre.
Les bénéfices thérapeutiques attendus sont une démonstration de ce double effet sur les critères d’imagerie ainsi qu’un retentissement clinique sur le handicap physique, la cognition, la fatigue et la qualité de vie.
Les traitements actuels sont limités à des agents anti-inflammatoires, et il existe un besoin urgent de thérapies innovantes capables de promouvoir la neuroprotection et la réparation de la myéline.
De nombreuses études épidémiologiques et cliniques ont mis en évidence des différences entre la femme et l’homme :
– Environ 3/4 des patients atteints de SEP sont des femmes.
– Les hommes déclarent une SEP de façon plus tardive (au moment où les taux de testostérone baissent), mais souffrent généralement de symptômes plus sévères sur le plan clinique, et se dégradent plus vite que les femmes.
– Une activité bénéfique des hormones sexuelles sur l’évolution de la maladie a été constatée (activité des œstrogènes durant la grossesse chez les femmes et de la testostérone chez les hommes).
– Les hommes atteints de SEP peuvent avoir un taux de testostérone inférieur au taux moyen.
Ces écarts entre les sexes dans la SEP pourraient être liés entre autre à des facteurs génétiques liés au sexe, à des différences dans la réponse immune ou à des effets des hormones sexuelles.
Ces observations ont stimulé l’intérêt pour les effets protecteurs potentiels des hormones sexuelles, et en particulier de la testostérone chez les patients atteints de SEP.
Les données actuelles montrent que la testostérone agit selon trois effets distincts: 1) un effet anti-inflammatoire 2) un effet neuroprotecteur et 3) un effet remyélinisant.
Ainsi l’objectif principal de l’étude TOTEM sera de déterminer par IRM les bénéfices du traitement sur l’évolution des marqueurs de neuroprotection et de remyélinisation que sont respectivement l’atrophie du thalamus et l’analyse du tenseur de diffusion dans les lésions. La tolérance au traitement ainsi que son efficacité seront également évaluées en utilisant d’autres séquences IRM, diverses échelles cliniques, cognitives et de qualité de vie, de fatigue et d’anxiété/dépression.
Cette étude est justifiée par le mécanisme d’action original de la testostérone agissant sur la neuroprotection et la remyélinisation dans la SEP, ainsi que son excellente tolérance. Ces modalités d’action représentent une nouvelle voie thérapeutique qui n’a pas d’équivalent dans l’arsenal thérapeutique actuel utilisé dans la SEP. Il n’existe notamment aucune molécule ayant une efficacité neuroprotectrice ou remyélnisante propre.
Les bénéfices thérapeutiques attendus sont une démonstration de ce double effet sur les critères d’imagerie ainsi qu’un retentissement clinique sur le handicap physique, la cognition, la fatigue et la qualité de vie.
Etude RADIAL-Valid: Validation de l’algorithme RADIAL pour le diagnostic des ataxies cérébelleuses récessives avec le Pr Christine TRANCHANT (AAP Support 2021).
Résumé du projet RADIAL-Valid
Les ataxies cérébelleuses de transmission autosomique récessive (ACAR) sont des maladies très invalidantes, d’aggravation progressive, aboutissant dans la majorité des cas à une perte de la marche en quelques années, et plus tardivement à une perte d’autonomie totale. Selon les gènes impliqués, la durée d’évolution ainsi que les pronostics fonctionnel et vital sont variables (Anheim et al 2012). Or, un diagnostic de certitude est indispensable pour un conseil génétique (pour le patient mais aussi pour ses apparentés) et une prise en charge adaptée, tenant compte du profil évolutif et des complications connues de la maladie en question. Le diagnostic de certitude de ces affections est un diagnostic génétique, mais reste aujourd’hui très difficile et très long en pratique clinique.
Afin d’améliorer ces difficultés de diagnostic, notre équipe a proposé le développement de différents outils d’aide au diagnostic. Nous avons proposé une démarche d’analyse clinique et paraclinique permettant d’orienter le diagnostic étiologique des ACAR [Anheim et al, 2012] et construit un algorithme automatisé de diagnostic des ACAR (RADIAL) regroupant les données cliniques et paracliniques de 67 gènes responsables d’ACAR [Renaud et al, 2017]. Cet algorithme doit permettre, pour le clinicien, d’orienter le diagnostic génétique et donc la demande de recherche de mutations dans les gènes les plus probablement impliqués compte tenu du phénotype du patient. La très bonne performance de cet algorithme a été démontrée, de même que sa supériorité par rapport à un groupe d’experts internationaux en termes de prédiction du génotype responsable du phénotype (Renaud et al). RADIAL pourrait également s’avérer efficace pour aider l’interprétation de résultats d’analyses génétiques et la prise de décision lors de réunions de confrontation génétique et clinique.
L’objectif de cette recherche est donc de valider de manière prospective chez des patients de novo, l’algorithme d’aide au diagnostic des ACAR : RADIAL.
Afin d’améliorer ces difficultés de diagnostic, notre équipe a proposé le développement de différents outils d’aide au diagnostic. Nous avons proposé une démarche d’analyse clinique et paraclinique permettant d’orienter le diagnostic étiologique des ACAR [Anheim et al, 2012] et construit un algorithme automatisé de diagnostic des ACAR (RADIAL) regroupant les données cliniques et paracliniques de 67 gènes responsables d’ACAR [Renaud et al, 2017]. Cet algorithme doit permettre, pour le clinicien, d’orienter le diagnostic génétique et donc la demande de recherche de mutations dans les gènes les plus probablement impliqués compte tenu du phénotype du patient. La très bonne performance de cet algorithme a été démontrée, de même que sa supériorité par rapport à un groupe d’experts internationaux en termes de prédiction du génotype responsable du phénotype (Renaud et al). RADIAL pourrait également s’avérer efficace pour aider l’interprétation de résultats d’analyses génétiques et la prise de décision lors de réunions de confrontation génétique et clinique.
L’objectif de cette recherche est donc de valider de manière prospective chez des patients de novo, l’algorithme d’aide au diagnostic des ACAR : RADIAL.